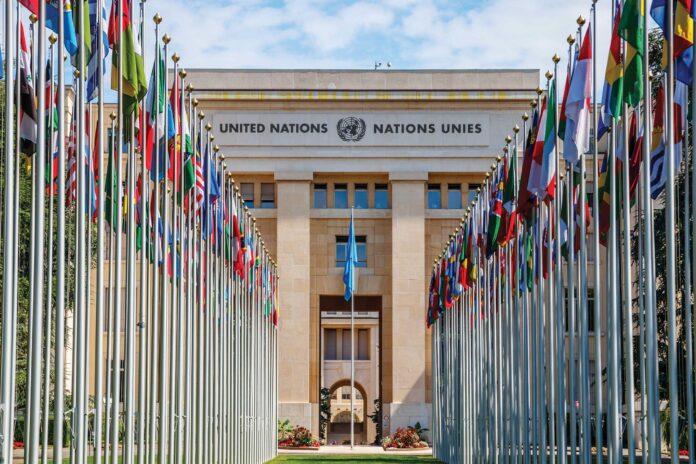La Communauté internationale se retrouve impuissante face à l’agression de la RDC par le Rwanda avec ses supplétifs M23 et AFC. Le constat est quasiment amer, malgré les condamnations et les appels incessants des grandes puissances, et autres exploits diplomatiques résultant au profit de la situation dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), dont la situation sur le terrain continue de se détériorer. L’examen du mercredi 16 avril, par le Conseil de sécurité de l’ONU sur les efforts de médiation entre Kinshasa et Kigali, a mis en lumière un fossé alarmant entre la dynamique diplomatique affichée et la réalité brutale sur le terrain. Les multiples ‘’cessez-le-feu’’ tant réclamés restent lettre morte, entretemps, que la crise humanitaire s’aggrave jour après jour, soulevant des questions sur la réelle influence et la capacité d’action des acteurs internationaux, y compris les plus puissants.
L’envoyé spécial de l’ONU pour les Grands Lacs, Huang Xia, a dressé un tableau sombre et préoccupant devant le Conseil des Nations, reconnaissant une « dynamique diplomatique encourageante » tout en déplorant une situation sur le terrain « toujours alarmante ». Cette controverse met en évidence une faiblesse intrinsèque voire un abandon de la situation part des grandes puissances, qui trouvent difficile à traduire des déclarations fermes et des décisions politiques en changement concret sur le terrain. Les appels répétés du Conseil de sécurité, des organisations régionales et de l’Union européenne à la cessation des hostilités semblent se heurter à une intransigeance persistante.
La frustration de Kinshasa, exprimée par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, face à une « impunité trop ancrée », résonne avec le sentiment d’une population civile otage d’un conflit qui perdure. Son appel renouvelé à des sanctions, souligne l’attente d’actions plus coercitives de la part de la communauté internationale. De son côté, l’ambassadeur rwandais à l’ONU a réitéré les préoccupations de son pays, par un discours familier et monologue, dont plusieurs points échappent dans l’éclairci du diplomate rwandais, qui tendant minimiser le rôle que joue Kigali dans la déstabilisation de la région.
L’exemple le plus frappant de cette impuissance relative est l’appel réitéré de Washington à Kigali. Pour la énième fois, les États-Unis, par la voix de Massad Boulos, Conseiller principal pour l’Afrique au Département d’État américain, ont exigé le retrait des forces rwandaises du territoire congolais et la cessation de tout soutien au groupe armé M23.
Cette déclaration, bien que ferme, soulève une question lancinante : jusqu’à quand ces interpellations resteront-elles sans effet tangible ?
L’incapacité des grandes puissances à faire respecter leurs propres demandes met en lumière plusieurs faiblesses. Premièrement, un manque de consensus et de volonté politique pour imposer des mesures contraignantes efficaces. Les intérêts divergents des acteurs internationaux et les considérations géopolitiques complexes peuvent freiner toute action décisive. Deuxièmement, une dépendance excessive à la diplomatie et à la médiation, qui, bien que nécessaires, s’avèrent insuffisantes face à des acteurs régionaux déterminés à poursuivre leurs propres agendas. Troisièmement, un déficit de mécanismes de contrôle et de vérification robustes pour s’assurer du respect des engagements pris.
Pourtant, des lueurs d’espoir persistent. L’ONU mise sur une coordination accrue des initiatives de paix, notamment à travers le rôle actif du président angolais João Lourenço et la désignation du président togolais Faure Gnassingbé comme nouveau médiateur de l’UA, l’accord sur un concept d’opération pour neutraliser les FDLR et la proposition de levée des mesures défensives rwandaises, si pleinement mis en œuvre, pourraient effectivement apaiser les tensions.
Néanmoins, la question demeure : comment transformer ces avancées diplomatiques fragiles en une réalité de paix et de sécurité pour les populations de l’Est de la RDC ? La communauté internationale, et en particulier les grandes puissances, doivent tirer les leçons de leurs échecs passés. Des déclarations fortes ne suffisent plus. Il est impératif de passer à des actions concrètes, potentiellement plus coercitives, et de mettre en place des mécanismes de suivi rigoureux pour garantir le respect des engagements et faire taire les armes dans cette région tourmentée. L’urgence humanitaire et la souffrance des civils exigent une réponse à la hauteur des moyens et de l’influence dont disposent les nations les plus puissantes du monde.
Yasmine Alemwa Ibango